Nous bâtirons notre maison, Seigneur, père Claude TASSIN
- bohleremmanuel

- 23 nov. 2020
- 3 min de lecture
Article publié dans la rubrique « chantez au Seigneur », de la revue trimestrielle de musique liturgique et d’art sacré « CAECILIA ». Edition du 15 mars 2014.

Le père Claude TASSIN est spiritain et professeur d’Ecriture Sainte à l’Institut Catholique de Paris. Comme Lucien DEISS, il fait partie de ces compositeurs qui ont œuvré en faveur du rayonnement des Ecritures. Il publia dans la collection « Cahiers Evangiles » un numéro spécial consacré à la « Réécriture des saintes Ecritures ». Il évoque le fait des croyants de toutes générations qui ont eu besoin de redire le texte biblique d’une manière qui puisse s’adresser à leurs contemporains. Cela devient la clef pour comprendre ses textes.
Le chant « Nous bâtirons notre maison » est une hymne strophique pour un mariage. Sa structure est simple : 6 quatrains, où le dernier est une reprise textuelle du premier. En fait, les strophes une et six sont la réécriture de la parabole de « la maison bâti sur le roc » (Mt 7, 21. 24-29). Quant aux strophes deux à cinq, elles proposent une réécriture des aspects du sacrement du mariage.
La construction littéraire sous forme litanique exprime la dynamique du mariage.
L’omniprésence du terme « Maison » dans les quatrains renvoie à la symbolique du couple. A ce terme s’adjoint des verbes évoquant construction et embellissement. Cela manifeste la dimension « d’envoi » du sacrement : le mariage est une histoire « en construction ».
La structure symétrique de chaque quatrain est résolument dialogale: une alternance entre un soliste (ou un chœur) chantant les deux premiers stiques, et l’assemblée chantant les deux autres. On pourrait presque le chanter avec deux solistes, et pourquoi pas si les mariés le peuvent, leur faire chanter en guise de prière commune après la bénédiction nuptiale.
Le texte est identique pour le premier stique du soliste (ou chœur) et celui de l’assemblée : il y a bien une œuvre commune, où chacun y apporte sa singularité.
La ligne mélodique est simple, épousant parfaitement la construction narrative, respectant l’organisation des stiques. Les deux dont le texte est répété, ne possèdent pas la même mélodie, ce qui renforce les cinq engagements prononcés par deux « voix ».
Tout d’abord, en lien avec la parabole, un acte de foi envers la fidélité de la Parole et de l’Amour de Dieu. Ceux qui le chantent, confessent qu’à travers l’échange des consentements, c’est Dieu qui manifeste son engagement.
Engagement du rejet de la violence et de la haine, écho de la parole de Moïse dans le Livre du Deutéronome (Dt 30, 15-20). Cela montre le lien entre mariage et baptême. Ce dernier nous a demandé, en toute liberté, à choisir le bien et à rejeter le mal. A travers le mariage et le don mutuel, cette liberté se déploie particulièrement.
Engagement à ce que le couple ne se ferme pas sur lui-même, mais au contraire qu’il devienne un lieu d’exercice concret de la charité envers le prochain. Cela rejoint les formules de bénédiction final, issus du nouveau rituel du mariage (2005) qui insistent sur cet aspect.
Engagement à la responsabilité de parents. Que le don mutuel des époux s’ouvre au don de la vie.
Enfin engagement à la fidélité à travers l’expression « garder ». Dans la déclaration d’intention les époux s’engagement à tout faire pour demeurer dans la fidélité et à se soutenir dans les épreuves. Ici, la fidélité devient manifestation de l’espérance qui habite dans le cœur des conjoints.
Ces quatre engagements concrets du couple ne peuvent se vivre et s’accomplir sur les seules forces humaines des conjoints, mais uniquement sur la fidélité de la Parole et de l’Amour de Dieu, chantée au début et à la fin.

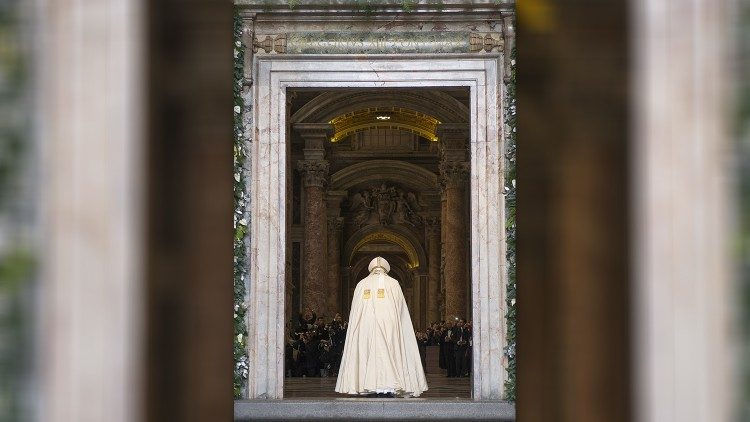

Commentaires